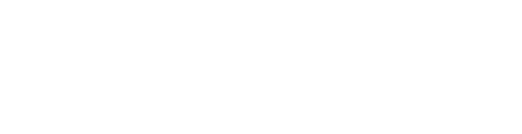Dans le cadre de la mission photographique Au Nom de la Biodiversité, le photojournaliste Frédéric Noy, grand spécialiste des questions environnementales et géostratégiques, s’est immergé des mois durant dans cet espace naturel menacé.
La Tanzanie, en Afrique de l’Est, compte 22 parcs nationaux sur son territoire. Celui d’Udzungwa, dans le centre du pays, abrite l’une des biodiversités les plus riches du continent africain, sur seulement 2 000 kilomètres carrés. Ses chutes d’eau, dont Sanje qui culmine à 170 mètres de hauteur, irriguent naturellement l’ensemble de la région.
L’année dernière, plus d’1,5 million de personnes s’y sont rendues, notamment dans les célèbres Kilimanjaro, Arusha et Serengeti. Mais seulement 8 000 sont allées dans celui d’Udzungwa, dans le centre du pays.
Pourtant, c’est dans ces montagnes recouvertes d’une épaisse végétation tropicale qu’a été découvert, au début des années 2000, le dernier spécimen de singe : le Kipunji (Rungwecebus kipunji). Mais pas de lions, pas de rhinocéros, pas de léopards… Alors les touristes le boudent. Pour les scientifiques, il reste l’un des sanctuaires les plus importants à protéger : ce territoire de seulement 2 000 kilomètres carrés abrite l’une des biodiversités les plus riches du continent africain. Ses chutes d’eau, dont Sanje qui culmine à 170 mètres de hauteur, irriguent naturellement l’ensemble de la région.

Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir le parc national d’Udzungwa en Tanzanie comme sujet pour ce reportage photographique ?
« J’ai beaucoup travaillé et vécu en Tanzanie, et j’avais envie d’y retourner pour y réaliser un sujet. De son côté, la Fondation Yves Rocher souhaitait elle aussi mettre en lumière le sanctuaire de biodiversité d’Udzungwa. Ce qui m’intéressait particulièrement, c’était d’explorer la relation entre les communautés locales et ce sanctuaire. Autrefois, elles pouvaient y accéder pour le bois ou la chasse ; aujourd’hui, cela leur est interdit. Pourtant, elles continuent de vivre à ses abords.
J’avais aussi envie de questionner la notion de conservation : d’un côté, l’éternité que symbolise la forêt primaire vieille de 100 millions d’années, et de l’autre, l’instant présent, le quotidien ordinaire, celui où il faut répondre à ses besoins et à ceux de sa famille. C’est dans cette tension entre éternité et immédiateté que réside, pour moi, tout l’intérêt de ce sujet.
La commande de la Fondation Yves Rocher m’a donné l’opportunité de réaliser ce projet comme j’aime le faire : sur le long terme. J’y ai consacré plus de cinq mois, répartis en trois séjours, pour capter différentes visions au fil des saisons. Ce temps long, cette densité, c’est précisément ce que rend possible le soutien de la Fondation. »

Comment avez-vous collaboré avec les communautés locales et les organisations comme Mazingira pour documenter cette réalité ?
« En photographie documentaire, le plus important pour moi, c’est de disparaître. Être là, mais peser le moins possible sur le récit, sur les personnes ou sur les sujets traités. Et paradoxalement, plus on est présent, plus on finit par devenir invisible : peu à peu, les gens cessent de prêter attention à vous.
Collaborer avec eux, c’est avant tout vivre à leurs côtés : partager leur quotidien, prendre le temps de les comprendre, leur parler, expliquer ma démarche, revenir, encore et encore. Être présent pour, finalement, s’effacer de leur existence. En somme, il faut être le plus présent possible pour réussir à être le plus absent possible. »

Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de votre immersion dans cette région isolée ?
« Le principal défi pour moi, c’était l’absence de littérature sur la région. Avant chaque départ, je documente beaucoup mes projets : je cherche ce qui a déjà été écrit, étudié, photographié… Mais là, sur ces montagnes, sur ce parc – qui n’est d’ailleurs qu’une petite partie de la région des Udzungwa – il y avait très peu de choses. Difficile donc d’anticiper les angles de l’histoire, de savoir de quoi j’allais parler, ou encore d’identifier les bons contacts. Sur place, il n’y avait presque aucune ONG, à peine une, qu’il a fallu dénicher, ainsi que quelques chercheurs et spécialistes capables de m’éclairer. Je partais donc de zéro.
Mon premier séjour, après un ou deux mois de recherche, a surtout servi à rencontrer ces personnes et à amorcer le récit. S’ajoutaient à cela les difficultés logistiques propres à un lieu si reculé : où dormir, comment se nourrir, comment se déplacer, trouver un guide… Autant de défis surmontés les uns après les autres. C’est aussi pour cela que j’ai besoin de temps : m’insérer, comprendre le tissu social, et saisir en profondeur ce qui se joue sur place. »
Dans cette même mission, retrouvez également le travail photographique de Brent Stirton au Pantanal, et de Mélanie Wenger dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.
Découvrez les photographies de cette mission présentées au Festival Photo de La Gacilly jusqu’au 5 novembre 2025 et à l’espace Frans Krajcberg jusqu’au 14 octobre 2025.
En découvrir plus